Sur «Ici-bas, ici même» (PIAS), neuvième album radieux en vingt ans de carrière, le Brestois tourmenté vire vocalement et musicalement de bord. Remontée du temps en un coup de fil.

Une voix qui chuchote et des oiseaux qui sifflotent. Dans sa maison du Finistère, Miossec s'est assis en terrasse, face à la mer. Posément, au bout du fil, le chanteur remonte le cours du temps, de là où il a repris pieds en amorçant un nouveau virage musical et vocal. Vingt ans d'un fleuve intranquille qui l'ont vu passer du fulgurant Boire (1995) qui a remué la chanson à la française à Ici-bas, ici même, neuvième album enregistré dans son cocon breton et navigant comme jamais en eaux calmes. « Pour arriver au stade d'épurement d'Ici-bas, ici-même, il a fallu énormément de travail en amont, de ratures et de textes bazardés. Au même titre qu'il m'a fallu du temps pour m'accepter pleinement en tant que chanteur et être à l'aise dans ce monde-là. Je crois que c'est important de s'être ramassé la tronche, de ne jamais être autosatisfait comme certains collègues qui, à trop vouloir monter sur l'estrade et faire les malins, en ont payé le prix fort après un licenciement général prononcé par le public.»
A contre-courant des électriques Chansons ordinaires (2011) et Finistériens (2009), Miossec est passé ainsi du tangage aux roulis, du rock tourmenté à une pop lumineuse. Le presque quinquagénaire a trop connu les remous pour ne pas apprécier cette sérénité inédite. «Après l’étiquette d’écorché vif, c’est celle d’homme apaisé que les médias me collent à la peau. Mais mes disques reflètent juste une vie normale constituée d’époques différentes et donc de hauts et de bas.» Soit. Mais comment s’est opéré ce virement de bord? «J’ai surtout voulu éviter de radoter et proposer autre chose. En termes d’écriture, j’ai chassé mes automatismes, éviter mon fonds de commerce pour tenter de viser des émotions plus universelles. Cet album m’a permis aussi d’assouvir le vieux fantasme de réaliser un disque à la maison, dépouillé, en peu de temps, en petit comité et sans pression ni souffrance. Un disque qui corresponde à mes humeurs musicales actuelles, où le jazz est très présent».
Allongé dans un cercueil
Puisque Chet Baker ou Nina Simone résonnent dans son salon et qu’une collaboration piano-voix avec le jazzman Baptiste Trontignon figure parmi ses meilleurs souvenirs scéniques récents, Miossec a fait appel pour la réalisation d’Ici-bas, ici-même au raffiné multi-instrumentiste et chanteur Albin de la Simone (Vanessa Paradis, Alain Souchon, JP Nataf, Arthur H ou Mathieu Boogaerts), présenté par un ami et ingénieur du son commun. Premières intentions et impressions piano-voix (et marimba, contrebasse), improvisations, prises sonores sur le vif et peu d’arrangements ajoutés, le répertoire revêt rapidement dans le sous-sol de sa maison mué en studio d’enregistrement les airs spontanés souhaités par son capitaine. Une voilure sonore à la délicate acoustique où le chant de Miossec, au premier plan, fluide et mélodieux, peut autant envahir l’espace que ménager d’habiles respirations.
Bien que les thématiques des chansons ne prêtent pas spécialement à sourire, la mort rôde souvent, Miossec s’épanouit vocalement comme rarement. «C’est vrai que je chante sans doute bien pour la première fois, comme si j’étais allongé dans un cercueil», s’amuse le Brestois qui, quant à l’irruption de la disparition au cœur de ces couplets, imagine d’abord en ironisant que «c’est dû à l’approche de la cinquantaine, des examens médicaux, etc». Avant de se raviser: «La mort a rôdé et rôde autour de moi. Le cancer devient une épidémie quotidienne et j’ai vu disparaître quelques proches ces dernières années (Alain Bashung ou Jean-Louis Foulquier, ndr). Mais si le thème aussi inépuisable que tabou de la mort s’est imposé, je ne voulais surtout pas l’accabler, qu’il soit plus mortifère encore. Je crois que ça a été mon plus grand défi et ma plus grande fierté en matière d’écriture pour Ici-bas, ici-même».
Un cap salutaire
La fuite du temps, obsession et angoisse durable de Miossec avec les ravages de l’amour, se trouve ici une maîtresse de taille grâce à des titres comme «On vient à peine de commencer», «Nos Morts», «A l’Attaque» ou «Des Touristes» qui se glissent dans les habits de la mort avec la subtilité d’un miraculé. Ne recensant plus seulement mélancoliquement les coups du sort, les plaies de l’âme et les gueules fracassées, Miossec trouve un cap salutaire pour ses chansons. Frottés au papier de soie plutôt qu’émeri, ces onze nouveaux titres gagnent en profondeur et émotion. A l’image de ses concerts autrefois sabordés, parfois sous l’emprise de l’alcool qu’il a depuis quatre ans arrêté sur injonction médicale, durant lesquels il confie enfin avoir retrouvé «un terrain de jeu formidable, qui donne de l’allant et un souffle neuf».
Et si l’ex-journaliste a baptisé sa tournée «Vingt ans dans la carrière», c’est juste pour mieux souligner, en plus du clin d’œil à ses origines ouvrières, la dimension laborieuse de sa «trajectoire de chanteur débutée sur le tard et furieusement à 30 ans. Les premiers moments sont toujours les plus forts. L’époque de Boire, ces deux premières années où la vie professionnelle bascule, était invraisemblable, surréaliste. Aujourd’hui, j’ai retrouvé sur scène ce plaisir et ces sensations fortes».
Cet article est aussi paru dans le quotidien suisse Le Courrier du 31 mai 2014
 La bienséance, le conformisme ou le politiquement correct sont ses ennemis déclarés. Avec Mauvais sentiments, Batlik conserve une dimension sociétale comme focale de ses chansons incisives et parfois jouissives. Pour ce neuvième album en dix ans, le Français chasse habilement la bien-pensance sous toutes ces coutures. « On vit dans une société gargarisée de bons sentiments. Les chansons de mon disque ont été pensées comme des contre-pieds à toutes ces idées reçues qui découlent souvent de la doctrine capitaliste omnipotente », détaille Batlik au bout du fil, militant à sa modeste façon.
La bienséance, le conformisme ou le politiquement correct sont ses ennemis déclarés. Avec Mauvais sentiments, Batlik conserve une dimension sociétale comme focale de ses chansons incisives et parfois jouissives. Pour ce neuvième album en dix ans, le Français chasse habilement la bien-pensance sous toutes ces coutures. « On vit dans une société gargarisée de bons sentiments. Les chansons de mon disque ont été pensées comme des contre-pieds à toutes ces idées reçues qui découlent souvent de la doctrine capitaliste omnipotente », détaille Batlik au bout du fil, militant à sa modeste façon.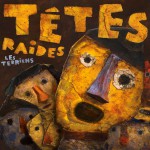 Intrépide sémaphore de l’alternative chansonnière depuis trente ans, les Têtes Raides s'en reviennent avec un douzième album studio fidèle à leur esprit franc-tireur. Toujours un peu pareil mais en même temps toujours un peu différent, leur répertoire poétique empruntant autant à Fréhel que Brel, Ferré, Leprest, Tom Waits ou The Clash creuse cette fois quelques pistes plus électriques. Où la prose néo-réaliste des Terriens, alternant militantisme (« La tâche ») et faux air de fête (« Les Terriens »), élans amoureux (« Alice », « Mon carnet ») et désillusions (« Oublie-moi»), se pare de belles profondeurs de champ et crissements guitaristiques.
Intrépide sémaphore de l’alternative chansonnière depuis trente ans, les Têtes Raides s'en reviennent avec un douzième album studio fidèle à leur esprit franc-tireur. Toujours un peu pareil mais en même temps toujours un peu différent, leur répertoire poétique empruntant autant à Fréhel que Brel, Ferré, Leprest, Tom Waits ou The Clash creuse cette fois quelques pistes plus électriques. Où la prose néo-réaliste des Terriens, alternant militantisme (« La tâche ») et faux air de fête (« Les Terriens »), élans amoureux (« Alice », « Mon carnet ») et désillusions (« Oublie-moi»), se pare de belles profondeurs de champ et crissements guitaristiques. Un tarmac en guise de bienvenue à bord de Parcs. Le béton pour signifier la verdure. Une fois de plus, la forme et le fond semblent en contradiction chez Bertrand Belin. Pourtant, à y regarder de près, le quatrième album du chanteur-conteur est plus cohérent qu’il n’y paraît. Tant Parcs est encore et avant tout une exquise invitation au voyage et vagabondage.
Un tarmac en guise de bienvenue à bord de Parcs. Le béton pour signifier la verdure. Une fois de plus, la forme et le fond semblent en contradiction chez Bertrand Belin. Pourtant, à y regarder de près, le quatrième album du chanteur-conteur est plus cohérent qu’il n’y paraît. Tant Parcs est encore et avant tout une exquise invitation au voyage et vagabondage.
